La question des restitutions d’oeuvres d’art est à la fois épineuse, complexe et … politique !
Nous nous retrouvons face à un nouvel exemple de demande de restitution d’oeuvres d’art “arrachées” à leurs terres de production. Ce n’est effectivement pas la première “histoire” de cette acabits que l’on peut lire, les relations entre la Grèce et le British Museum en sont empoisonnées ! (cher Lord Elgin !)
Il me semble qu’il faut tout d’abord distinguer deux cas de figure différents : les oeuvres qui ont été emportées et celles qui ont été achetées. Celles qui ont été achetées ne posent, a priori, pas de problème à condition que la transaction fut faite face au bon vendeur (pas d’achat d’oeuvre volée ou de propriétaire non légitime, comme par exemple lors d’une domination par un autre pays). En ce qui concerne la première situation, le terme “emportées” permet de définir à la fois les vols tels qu’ils sont reconnus actuellement par les différentes lois qui régissent les biens mais également de désigner des objets qui ont été tout simplement récupérés sur un lieu dit et amenés ailleurs, sans se soucier de l’environnement dans lequel ils ont été (re)trouvés.
Les musées occidentaux sont largement constitués de ces objets “emportés”. La question de la “légalité” ou plutôt de la légitimité de transférer des objets provenant de fouilles, de prises de guerre et a fortiori de dons dans ces lieux de conservation et de diffusion aux publics ne se posait alors même pas. Sans revenir aux débuts des créations des musées, rappelons tout de même que le phénomène de création et/ou d’accroissement de manière importante des collections de musées date principalement de la fin du XVIIIème s. et du XIXème s. (voire, pour les collections ethnologiques, également de la première moitié du XXème s.).
Sans chercher à dédouaner mais à comprendre, on ne peut juger à l’aune de notre XXIème s. ce qui était usages lors de ces périodes. En effet, si l’on prend l’exemple de l’archéologie et de ses fouilles, on voit une très nette évolution entre “je creuse un trou, je trouve un truc, je l’époussette, je marque dans mon carnet de bord/mémoires ce que j’ai trouvé, j’essaie de lier ça aux autres savoirs que l’on a déjà de la période ou région (avec plus ou moins de justesse) et je montre ça au roi pour me faire mousser” et “on va creuser sur cette parcelle, on la quadrille, on dessine et photographie tout ce que l’on y trouve, on utilise le pinceau et une montagne de précautions pour déplacer ou “fixer” l’objet, on envoie en restauration et on écrit un article dessus (si on a trouvé un éditeur)”. Cette manière de pensée “scientifique” est applicable à tout objet récolté durant ces siècles. Ce qui comptait alors c’est l’objet non son environnement.
Cela vaut tant pour le terrain archéologique de l’objet que son lieu d’exposition ainsi que son pays d’origine ! A ce schéma de pensée s’ajoute également des considérations plus ou moins avouables. En effet, la compréhension du pays d’où provient l’oeuvre, de son pouvoir politique et de sa culture est primordiale, soit :
-il s’agit d’un pays “civilisé” (à entendre de la civilisation européenne) dans quel cas, il a déjà ses propres collectionneurs et chercheurs (si tous les chercheurs étaient des collectionneurs, l’inverse n’était pas vrai !) et donc on achète ou on échange (cadeaux diplomatique, qui pouvaient soit être un objet remarquable et ancien dont le prince était prêt à se séparer pour raisons politiques, soit un produit de l’artisanat contemporain local)
-ce sont des “sauvages” et dans quel cas les Européens étaient “dans leurs bons droits” de récolter autant d’objets que ces collectionneurs considéraient importants de récupérer (pour faire connaître ces civilisations aux Européens et/ou pour montrer l’esthétique ou la richesse de ces objets, à peine reconnus comme oeuvres d’art, en tout cas toujours comme curiosités). Je force certes un peu le trait mais afin de permettre une meilleure compréhension
-le pays est sous domination étrangère et dans quel cas, on négociait avec l’Etat de tutelle. Parangon de ce cas de figure : la Grèce, territoire sous domination ottomane.
Ces derniers cas posent le débat actuel : les institutions dépositaires ou propriétaires de ces oeuvres doivent-elles rendre au pays d’origine les objets qu’elles conservent, pour certaines, depuis plus de 200 ans ? Et encore ! Si l’on veut être encore plus extrêmes, il faudrait dire : doit-on rendre au terrain d’origine l’oeuvre ! En effet, si l’on reprend l’argumentaire de Quatremère de Quincy quant à l’importance de la contextualisation de l’oeuvre (argumentaire développé lors des guerres napoléoniennes qui avaient … considérablement augmentées les collections des musées français !) et donc sa présentation in situ, il faudrait alors exiger une présentation et une conservation sur place… ah oui mais voilà : l’argumentaire des pays exigeant les restitutions s’appuie sur “ces oeuvres appartiennent à notre peuple/pays/civilisation, c’est à nous d’en disposer !”. Autrement dit, les questions identitaires rentrent dans le jeu en plus du sujet de la légitimité. Et là, les choses se compliquent encore d’avantage. En effet, si la question du temps de conservation en un endroit et sa réinvention (autant dans le sens “donner un sens supplémentaire à l’objet existant” que dans celui du juriste de redécouverte aux “yeux du monde”) est déjà épineuse à traiter, les enjeux nationalistes ou identitaires sont presque impossibles à gérer !
A côté de ces considérations, la question du tourisme culturel est bien évidemment un enjeu réel. En effet, récupérer des “oeuvres phares” permettraient, tel le phare d’Alexandrie à son époque, guider les touristes-visiteurs vers le port culturel … du musée national ! Et, on ne le dit que trop (et parfois à travers) en ce moment : la culture ça dépense trop mais ça peut rapporter gros !
Evidemment, on peut tout à fait logiquement critiquer les institutions occidentales (puisque la palme est également partagée avec les musées américains) qui veulent “garder leurs trésors” et ne pas se voir déposséder de la moitié de leurs collections (à l’instar de Vivant Denon qui, face aux Alliés qui voulaient récupérer au Musée Napoléon (futur Musée du Louvre) les oeuvres pillées lors des campagnes napoléoniennes, s’est battu bec et ongles pour garder le maximum d’oeuvres (redevenues) étrangères). Néanmoins, il me semble nécessaire d’évoquer également les points suivants :
1) Les musées qui se sont constitués à la fin du XVIIIème s.-première moitié du XIXème s. avaient pour objectif l’universalité. Présenter aux publics tant des oeuvres contemporaines, nationales mais également étrangères et de toutes époques. Bien sûr, les présentations étaient alors perfectibles et la quantité était facilitée par les conditions de récolte. Néanmoins, grâce à cette concentration d’objets, de périodes et d’arts, artistes, scientifiques ainsi que publics ont pu s’ouvrir à d’autres cultures et développer les appétences. On ne peut (ni ne doit à mon sens) nier l’importance et l’impact d’une telle concentration.
2) Ces musées présentent donc depuis 100 à 200 ans ces objets. La question est très complexe et je n’en ai pas la réponse mais le débat se pose, selon moi, dans les termes suivants : peut-on considérer que l’histoire contemporaine prime sur le passé de création de l’oeuvre ? Pour les objets redécouverts (par des fouilles ou par des collectes d’objets ne servant plus comme certains masques de parade religieuse africains), ces institutions culturelles qui les présentent aux publics en sont-elles les inventrices ? (au sens juridique du terme) … Mais, si les fouilles avaient été exécutées au cours des trois dernières décennies, les oeuvres auraient été exposées et conservées in situ (ou à la capitale du pays originaire) … Mais si ces objets, conservés depuis longtemps dans un pays occidental, sont restitués, garderaient-ils le même sens ?
En effet, les oeuvres présentées dans les musées occidentaux revêtent plusieurs significations : leurs sens intrasèques (quel objet ? Quelles techniques ? Quel contexte socio-éthnographique ? Quelle compréhension dans l’histoire de l’art ? …) mais également celui de l’exposition aux yeux de visiteurs et non plus aux seuls collectionneurs ou utilisateurs. Ainsi, le fait même que l’expôt soit conservé dans un musée (a fortiori si ce-dernier est reconnu pour son caractère remarquable ou de référence à l’échelle mondiale) lui confère une dimension supplémentaire car l’inscrit alors dans une autre histoire (celle du monde moderne et contemporain, celle des institutions muséales également, …) et donc un caractère supplémentaire. L’objet devient alors multi-couches, fort de ses histoires et non plus que dans son contexte de production.
Par ailleurs, ces oeuvres sont actuellement -et le plus souvent- contextualisées, présentées auprès d’autres expôts qui apportent sens et complémentarité… or ces objets seraient soit renvoyés dans d’autres pays ou restés (faute de réclamations ?) dans le musée. A l’heure à laquelle on parle toujours d’avantage d’accessibilité à la culture, ces “pertes” imposeraient aux publics amateurs d’aller dans les pays pour voir les oeuvres … Pour l’accessibilité (qu’elle soit physique ou budgétaire) on repassera ! Bien sûr, l’argument peut-être renversé : les publics vivants dans les pays dont sont originaires ces oeuvres pourraient en revanche enfin accéder bien plus facilement à ces objets de leurs cultures …
A noter que cette problématique rejoint, selon moi, la même question des oeuvres nationales. Je m’explique : on observe depuis quelques années que la France essaie d’acheter toutes les oeuvres du Poussin or il y a un véritable intérêt que les oeuvres de ce peintre soient présentes dans le plus grand nombre d’institutions et pays possibles car cela permettrait alors de diffuser largement un savoir-faire (la fameuse “excellence à la française”) mais également permettrait à un plus grand nombre de publics de découvrir sa peinture et peut-être même d’autres peintres de l’époque et/ou français !
3) La question de la conservation est également à envisager. En effet, l’argument de la bonne conservation par et entourée de professionnels est souvent avancé. Pour ce qui concerne les professionnels, ils peuvent être formés et/ou transfugés. Après tout, on a beaucoup de professionnels des musées qui ne trouvent de travail en France, cela pourrait être l’occasion de former et d’assurer une transition en douceur et pratique pour tout le monde. En revanche cela pose alors la question de l’uniformisation des techniques. Or, il apparaît que chaque aire culturelle a sa propre conception et son propre rapport à l’art. Toucher/ne pas toucher, présenter de telle ou telle manière, objectivité ou servir une idéologie, … je ne pense pas que l’on puisse aller jusqu’à la damnatio memoriae mais ces questions doivent être débattues et encadrées car acceptera-t-on alors une seule voie (avec ses défenseurs, son commissariat, …) ou une diversité de conceptions ?
Autre volet de la conservation de l’objet : son intérgité physique. En effet, il est souvent craint que si les oeuvres retournaient dans leur pays d’origine, elles ne pourraient rester en sécurité. On a pu le voir avec l’Irak, l’Egypte, la Libye ou encore plus proche de nous : la Syrie. Il faut dire qu’il y a une certaine concordance entre les pays “spoliés” de leurs trésors nationaux et les pays dont la stabilité politique et économique est … difficile. Il paraîtrait “légitime” de vouloir protéger ces oeuvres en ne les mettant pas dans des pays qui pourraient s’embraser à tout moment et ne plus s’intéresser à l‘intégrité de ses trésors nationaux quand les vies humaines sont en jeu … Néanmoins, l’Irak et l’Egypte ont montré que quand un pays est conscient de sa culture (matérialisée par une collection importante d’oeuvres) il est tout à fait capable de la protéger ! Autre contre-exemple : les bombardements de musées allemands durant la Seconde Guerre Mondiale …
Bien sûr, ces réflexions tiennent autant pour les collections publiques que privées … or, à ma connaissance, aucun pays n’est venu réclamer de restitution aux collectionneurs privés …
En parlant de collectionneurs privés, certaines pratiques qui semblent particulièrement usitées dans les milieux d’art contemporain et qui me semble pertinent d’évoquer ici : la spéculation sur l’art. On le sait depuis longtemps, l’art est un marché. Et si l’on en croit ce documentaire, un marché plutôt juteux. Cependant, ce qui peut inquiéter les institutions dans le cadre d’hypothétiques restitutions, ce sont les ventes qui pourraient suivre (comme on peut régulièrement en lire dans le Journal des Arts avec les biens restitués après les spoliations nazies). Ces oeuvres qui sont à présent visibles par une très grande majorité de publics pourraient devenir l’apanage que d’un petit nombre … jusqu’à ce qu’un musée réussisse à nouveau à mobiliser des donateurs privés pour acheter l’oeuvre qu’il possédait dans le passé ou “pire” (pour le contribuable) : que l’Etat l’achète dans sa totalité … et dans quel cas, le retour en collection publique serait quasiment impossible en dehors de donations …
Enfin, on lit régulièrement dans les journaux des restitutions d’oeuvres par des institutions culturelles occidentales … Cependant, ces restitutions touchent des oeuvres acquises récemment (comme on peut le voir avec l’exemple du Louvre qui rend à l’Egypte une oeuvre qu’elle avait acheté de bonne foi mais qui avait été précédemment acquise dans des conditions … peu claires !) ; il est très rare que l’acquisition de ces oeuvres restituées ait été faite avant ces cinq dernières décennies.
Les pays qui arrivent à se faire restituer certaines oeuvres conservées depuis plus longtemps usent de chantage. Si le mot n’est pas politiquement correct, l’exemple du sphinx de Hattusha semble être assez éclairant … Attention : je n’émets absolument aucun jugement de valeur ! Ce n’est ni mon rôle ni mon propos ! Mais il est tout de même dommage que l’on arrive à ces extrémités là, … par les deux parties !


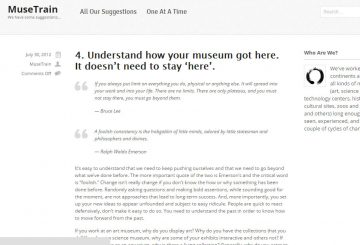
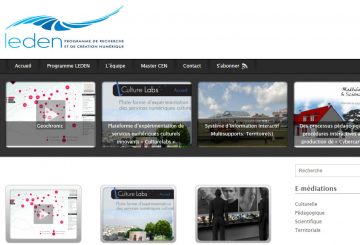
![[Chapter 11] Scenario and technology serve the territory narration](http://heleneherniou.com/cliophile/wp-content/uploads/2014/07/IMG_1888-360x245.jpeg)
You must be logged in to post a comment.