Publié le 14/10/2012 à 12h08 sur Rue 89 par Pierre-Carl Langlais, wikipédien [voir aussi @Dorialexander]
“Le piratage ne cesse de défrayer la chronique, mais curieusement, on parle beaucoup moins du phénomène inverse : le « copyfraud » ou fraude de copyright. Il ne s’agit pas de diffuser indéfiniment une œuvre protégée, mais au contraire d’effectuer une fausse déclaration de droit d’auteur entraînant la protection frauduleuse d’un contenu librement accessible.
Le copyfraud est sans doute aussi répandu que le piratage. Cependant, les contrevenants sont rarement, voire jamais condamnés. Il faut dire que certains d’entre eux ont pignon sur rue : le Times britannique, la Réunion des musées nationaux, la Bibliothèque nationale de France, un département français…
Définir le copyfraud
Le copyfraud a été défini il y a quelques années par un juriste américain, Jason Mazzone. En 2006, il y consacre une analyse approfondie dans le New York University Law Review. Le copyfraud regroupe quatre infractions définies, plus ou moins explicitement, dans la plupart des législations européennes et américaines :
- la fausse déclaration de possession d’un contenu tombé dans le domaine public ;
- la prétention à imposer des restrictions d’utilisation non prévues par la loi ;
- la prétention à privatiser un contenu en arguant de la détention d’une copie ou d’une archive de ce contenu ;
- la prétention à privatiser un contenu tombé dans le domaine public en le diffusant sous un nouveau support.
Ces infractions ne sont presque jamais réprimées. Comme le souligne Jason Mazzone, le législateur ne définit, le plus souvent, qu’une culpabilité théorique, sans application pratique :
« Les lois sur la propriété intellectuelle souffrent d’une grave défaillance : les importantes garanties apportées au respect du droit d’auteur ne sont pas du tout compensées par des garanties comparables pour le domaine public. »
Le code de la propriété intellectuelle français se contente ainsi d’une définition négative : le domaine public commence lorsque les droits d’auteur expirent. Or, si le délit de contre-façon est sévèrement condamné (selon l’article L335-2, « de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende »), le délit de copyfraud ou attribution frauduleuse de droit d’auteur ne donne lieu à aucune pénalité explicite.
Pourtant, d’un point de vue éthique, le copyfraud est aussi grave que le piratage. Privatiser le domaine public n’implique pas un préjudice pour un particulier ou une entreprise, mais pour tout le monde. On porte atteinte au patrimoine commun d’une collectivité, voire de l’humanité.
Copyfraud des institutions culturelles françaises
« Le copyfraud est partout », nous assure Jason Mazzone. La France ne fait pas exception à cette déclaration générale. Le blogueur Calimaq a récemment attiré l’attention sur la multiplication des copyfrauds dans les grandes institutions culturelles françaises.
Depuis sa fondation, le service Gallica de la Bibliothèque nationale de France distribue ses documents sous une licence erronée. Chaque fois qu’un internaute télécharge un contenu, il doit obligatoire cocher la case portant l’inscription suivante :
« Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’utilisation non commerciale et je les accepte. »
Or, ces conditions d’utilisation n’ont aucune valeur : on peut très bien revendre un livre imprimé depuis Gallica (ne serait-ce que pour tenir compte des frais d’encre et de papier).

Les conditions de réutilisation non commerciale de Gallica
La Réunion des musées nationaux pousse le vice plus loin. Cette institution ne tente pas seulement de limiter la diffusion, mais bel et bien de privatiser le domaine public.
Cette reproduction de « La Joconde » porte ainsi la mention « (C) RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) Michel Urtado ». Le principe invoqué est celui des droits d’auteur du photographe. Dans la mesure où il s’agit d’une simple reproduction sans aucun apport esthétique, cette prétention n’a aucune valeur – et a d’ailleurs toujours été niée par la jurisprudence française.
Une œuvre vieille de 17 000 ans protégée ?
Un récent article de Sud-cuest révèle un copyfraud carrément ubuesque. Le département de la Dordogne a tenté d’empêcher la diffusion d’un fac-similé de la grotte de Lascaux, au motif qu’il « constitue une contrefaçon qui porte gravement atteinte à l’intégrité du patrimoine national ». Concrètement, on suggère qu’une œuvre vieille de 17 000 ans serait protégée. Si tel est le cas, l’identification des ayants droit devrait poser quelques difficultés…
Vers l’institutionnalisation du copyfraud ?
Toutes ces infractions sont dérisoires par rapport à ce qui se prépare. Dans un contexte de restriction budgétaire, les bibliothèques publiques sont contraintes de négocier des partenariats avec des entreprises privées. Or, pour les intéresser, elles proposent de plus en plus souvent des privatisations temporaires de contenus placés dans le domaine publique.
Concrètement, pendant une durée de cinq à dix ans, l’investisseur dispose d’une sorte de privilège de commercialisation : les numérisations sont inaccessibles au public et cédées, moyennant finance, à des institutions ou des particuliers.
Le projet Investisseur d’avenir de la Bibliothèque nationale de France détaille ce fonctionnement en ces termes :
« La protection des investissements et les perspectives de recettes se font essentiellement par l’adoption d’une exclusivité au profit du partenaire, le temps que celui-ci amortisse ses coûts. La BNF a fait en sorte dans ses négociations d’en limiter la durée et la portée. Ainsi, par principe pour tous les projets, un accès intégral dans les salles de lecture a été préservé. »
Des privatisations indues du domaine public
La France tend, en somme, à s’aligner sur un contre-modèle britannique où les privatisations du domaine public sont monnaie courante. La quasi-totalité des archives de la presse anglaise sont ainsi monétisées sur Internet. Les archives du Times depuis 1785 ne sont accessibles que moyennant un abonnement.
En outre, chaque exemplaire est orné de la mention « © Times Newspapers Limited ». Cette attribution est d’autant moins recevable que la loi anglaise sur le copyright n’est pas très généreuse avec les journaux et les éditions collectives : la protection disparaît apparemment 25 ans après la première publication. Sur 220 ans d’archives numérisées, 200 sont privatisées illégalement.
Plutôt que de mettre fin au copyfraud, les Etats pourraient être tentés de lui conférer une validité légale. Le traité de diffusion actuellement discuté par l’Organisation de la propriété intellectuelle (OMPI) va dans le sens de cette évolution : chaque contenu diffusé pourrait être protégé par l’agence émettrice, même s’il est tombé dans le domaine public ou distribué originellement sous licence libre.”



![[Chapter 13] Behind the voice](http://heleneherniou.com/cliophile/wp-content/uploads/2014/11/Programme-3-Virtual-Revolution-voice_over-my-view-through-the-square-window_by-Aleks_httpswww.flickr.comphotostoastkid-360x245.jpg)
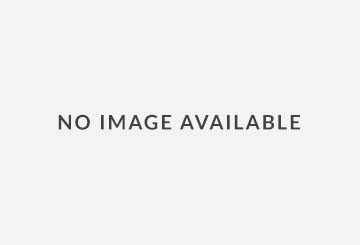
![[Chapter 5] What does a Community Manager? The Quai Branly Museum example](http://heleneherniou.com/cliophile/wp-content/uploads/2013/05/mqb_twitter1-360x245.jpg)