A la suite du musée Guggenheim, un certain nombre d’institutions culturelles occidentales se sont lancées dans de spectaculaires opérations de délocalisation, jouant la carte d’une exportation de leur marque et de leur savoir-faire. Entre diplomatie d’influence et marketing culturel, sans oublier la manne financière que représentent de tels projets, musées et universités occidentales tentent leur chance dans les nouveaux paradis du Moyen-Orient ou d’Asie. Pour quels bénéfices ? Selon quelles stratégies ?
ParisTech Review – Dans le contexte de mondialisation, la culture joue aussi un rôle qui, s’il est beaucoup moins important en volume que celui des entreprises privées, revêt cependant un poids symbolique important lorsqu’il s’agit d’institutions aussi célèbres que le Guggenheim, qui fut pionnier en la matière, ou le Louvre. Comment ce mouvement est-il né ? Selon quelles modalités ? Laurent Martin – Les premiers projets remontent aux années 1970, mais l’impulsion majeure date de l’arrivée de Thomas Krens à la direction de la Fondation Guggenheim, en 1988, dans un contexte d’endettement de l’institution notamment dû aux coûts de l’immeuble new-yorkais. Thomas Krens va lancer et approfondir pendant ses 20 ans à la tête de la fondation toute une politique d’acquisitions d’œuvres et d’expositions visant à rétablir les finances de l’institution qu’il dirige. C’est dans cet esprit qu’il développe un système de franchise qui aboutit à l’ouverture du Guggenheim Bilbao en 1997. Le fonctionnement en est simple : le Guggenheim apporte son nom, son expertise et sa collection tandis que le partenaire (la province basque en l’occurrence) est en charge de l’immeuble (construction et frais de fonctionnement), des expositions et du personnel.  Ce modèle a inspiré l’implantation du musée de l’Ermitage à Las Vegas en 2001 (fermé depuis) et du Louvre à Abu Dhabi. Le célèbre musée parisien a ainsi vendu son nom pour 30 ans moyennant 400 millions d’euros ; le contrat est assorti de prêts d’œuvres sur 10 ans, le volume desdits prêts tendant à diminuer pour être progressivement remplacés par des œuvres acquises par Abu Dhabi grâce à l’expertise des conservateurs du Louvre. François Chaubet – On peut distinguer deux modèles assez différents, aussi bien par leurs visées que par le contexte dans lequel ils s’inscrivent. Le Guggenheim est une institution privée, le Louvre un musée public, et plus précisément un musée national. La délocalisation, dans ce cas, n’est pas simplement recherche d’un nouveau public ou d’un nouveau marché, mais plus largement une entreprise de rayonnement culturel. Cette entreprise s’inscrit dans une histoire longue, dont témoignent aussi le réseau des alliances françaises ou les lycées français à l’étranger. Il s’agit de diffuser un savoir, de faire rayonner une expertise. Ce n’est pas un hasard si, beaucoup plus que le musée new-yorkais, le Louvre privilégie et met en avant l’expertise de ses conservateurs dans son projet ultra-marin. Dans un contexte de mondialisation, les vieilles puissances entendent conserver un primat scientifique qui fut aussi l’un des enjeux du colonialisme. D’un autre côté, le projet du Louvre se veut aussi plus ambitieux intellectuellement que celui du Guggenheim. Il est fondé sur un temps long permettant a priori un équilibre dans le partenariat envisagé. Il ne s’agit pas simplement de franchiser, mais bien de créer une nouvelle institution, et non une simple réplique du musée français. Ce mouvement doit être replacé dans une évolution plus large qui a vu l’accélération, ces trente dernière années, des circulations dans le monde de l’art : multiplication des biennales et des foires artistiques, des expositions qui voyagent dans plusieurs pays, dont les curateurs sont de plus en plus souvent issus des pays émergents, et qui montrent des artistes non occidentaux : l’un des points de départ de cette dernière tendance fut la grande exposition « Magiciens de la terre » en 1989, au Centre Georges Pompidou. Les délocalisations que nous évoquons s’inscrivent dans ce mouvement brownien des œuvres et artistes qui associent pays occidentaux et, de plus en plus, pays émergents, même si le marché de l’art contemporain reste dominé par les standards occidentaux. Dans ce contexte, les grands musées occidentaux sont tentés de devenir des « bibliothèques de prêt mondiales », pour citer le directeur du British Museum. On a là une histoire post-coloniale du musée universel occidental. Pour approfondir la comparaison entre ces deux modèles typiques, les institutions travaillent-elles pour leur propre compte ou sont-elles des instruments d’une stratégie politique plus large ? François Chaubet – Les deux dimensions existent et ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Par exemple, le projet du Louvre d’Abu Dhabi est correspond à une stratégie de développement propre à l’institution, qui doit notamment rechercher de nouvelles ressources. Mais c’est aussi une aubaine pour l’État français. Géographiquement, les Émirats se situent dans une zone d’intersection qui permet à la France de manifester son influence et son prestige dans cet endroit du monde, un carrefour où se croisent les nouvelles élites mondiales. Les émirats sont un lieu de villégiature particulièrement recherché par la upper middle class des grands pays émergents. Il y a ici un enjeu de soft power, pour reprendre la fameuse expression de Joseph Nye. Pour le Guggenheim, l’effet soft power n’est sans doute pas pour déplaire à la Maison Blanche, mais l’initiative me semble plus clairement du ressort du Guggenheim en tant qu’institution privée, et ses motivations sont avant tout économiques – ou plus précisément financières. On trouve d’ailleurs une stratégie comparable avec la diffusion mondiale des opéras du Met dans les salles de cinéma. Il s’agit pour l’institution de prendre place dans un marché global et d’aller chercher son public – ses clients – hors les murs. Mais les Etats ne sont pas indifférents à ces stratégies qui servent aussi leurs intérêts. La diplomatie culturelle, depuis 15 ans, a fortement privilégié ces dossiers de coopération muséale, très prestigieux et très visibles, à l’instar du président russe Vladimir Poutine et du président du conseil italien Romano Prodi qui signèrent un accord entre la ville de Ferrare et l’Ermitage en mars 2007. Avec des bonheurs divers : la ville de Taichung, à Taïwan, refusa par exemple l’implantation d’une antenne Guggenheim en 2003 au nom du refus de « l’hégémonie américaine » ! On peut sourire, mais il faut se souvenir qu’en Europe, lors de l’ouverture du musée de Bilbao, des voix se sont élevées pour dénoncer une relecture biaisée de l’histoire de l’art contemporain : le Guggenheim racontait au public européen une histoire américaine. Laurent Martin – Dans le cas du Louvre, n’oublions pas non plus que ces coopérations s’inscrivent dans le contexte d’échanges bilatéraux qui concernent aussi et avant tout d’autres biens. La France vend par exemple des armes à Abu Dhabi. Il existe donc un croisement d’intérêts dans lequel l’État, qui est signataire de ces accords, trouve son compte. Et pas seulement par rapport au partenaire étranger : la pression exercée par l’Etat sur de grands opérateurs comme le Louvre, afin que leur taux d’autofinancement puisse croître, encourage ces initiatives qui permettent de réduire la participation de l’Etat dans les finances du musée en leur substituant des fonds étrangers : c’est le mécanisme du mécénat à grande échelle. C’est d’ailleurs un généreux mécénat en provenance d’Abu Dhabi qui a permis la restauration récente du château de Fontainebleau. François Chaubet – Le montage d’un projet comme le Louvre-Abu Dhabi est emblématique. La diplomatie d’influence, qui constitue la pierre angulaire de la stratégie du Quai d’Orsay, est fondée sur une expertise technique dont on pourrait trouver des échos aussi bien dans les hôpitaux implantés par la France en Inde que dans le réseau culturel français à l’étranger, qui joue la carte de l’implantation durable et de la coopération avec les partenaires locaux.
Ce modèle a inspiré l’implantation du musée de l’Ermitage à Las Vegas en 2001 (fermé depuis) et du Louvre à Abu Dhabi. Le célèbre musée parisien a ainsi vendu son nom pour 30 ans moyennant 400 millions d’euros ; le contrat est assorti de prêts d’œuvres sur 10 ans, le volume desdits prêts tendant à diminuer pour être progressivement remplacés par des œuvres acquises par Abu Dhabi grâce à l’expertise des conservateurs du Louvre. François Chaubet – On peut distinguer deux modèles assez différents, aussi bien par leurs visées que par le contexte dans lequel ils s’inscrivent. Le Guggenheim est une institution privée, le Louvre un musée public, et plus précisément un musée national. La délocalisation, dans ce cas, n’est pas simplement recherche d’un nouveau public ou d’un nouveau marché, mais plus largement une entreprise de rayonnement culturel. Cette entreprise s’inscrit dans une histoire longue, dont témoignent aussi le réseau des alliances françaises ou les lycées français à l’étranger. Il s’agit de diffuser un savoir, de faire rayonner une expertise. Ce n’est pas un hasard si, beaucoup plus que le musée new-yorkais, le Louvre privilégie et met en avant l’expertise de ses conservateurs dans son projet ultra-marin. Dans un contexte de mondialisation, les vieilles puissances entendent conserver un primat scientifique qui fut aussi l’un des enjeux du colonialisme. D’un autre côté, le projet du Louvre se veut aussi plus ambitieux intellectuellement que celui du Guggenheim. Il est fondé sur un temps long permettant a priori un équilibre dans le partenariat envisagé. Il ne s’agit pas simplement de franchiser, mais bien de créer une nouvelle institution, et non une simple réplique du musée français. Ce mouvement doit être replacé dans une évolution plus large qui a vu l’accélération, ces trente dernière années, des circulations dans le monde de l’art : multiplication des biennales et des foires artistiques, des expositions qui voyagent dans plusieurs pays, dont les curateurs sont de plus en plus souvent issus des pays émergents, et qui montrent des artistes non occidentaux : l’un des points de départ de cette dernière tendance fut la grande exposition « Magiciens de la terre » en 1989, au Centre Georges Pompidou. Les délocalisations que nous évoquons s’inscrivent dans ce mouvement brownien des œuvres et artistes qui associent pays occidentaux et, de plus en plus, pays émergents, même si le marché de l’art contemporain reste dominé par les standards occidentaux. Dans ce contexte, les grands musées occidentaux sont tentés de devenir des « bibliothèques de prêt mondiales », pour citer le directeur du British Museum. On a là une histoire post-coloniale du musée universel occidental. Pour approfondir la comparaison entre ces deux modèles typiques, les institutions travaillent-elles pour leur propre compte ou sont-elles des instruments d’une stratégie politique plus large ? François Chaubet – Les deux dimensions existent et ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Par exemple, le projet du Louvre d’Abu Dhabi est correspond à une stratégie de développement propre à l’institution, qui doit notamment rechercher de nouvelles ressources. Mais c’est aussi une aubaine pour l’État français. Géographiquement, les Émirats se situent dans une zone d’intersection qui permet à la France de manifester son influence et son prestige dans cet endroit du monde, un carrefour où se croisent les nouvelles élites mondiales. Les émirats sont un lieu de villégiature particulièrement recherché par la upper middle class des grands pays émergents. Il y a ici un enjeu de soft power, pour reprendre la fameuse expression de Joseph Nye. Pour le Guggenheim, l’effet soft power n’est sans doute pas pour déplaire à la Maison Blanche, mais l’initiative me semble plus clairement du ressort du Guggenheim en tant qu’institution privée, et ses motivations sont avant tout économiques – ou plus précisément financières. On trouve d’ailleurs une stratégie comparable avec la diffusion mondiale des opéras du Met dans les salles de cinéma. Il s’agit pour l’institution de prendre place dans un marché global et d’aller chercher son public – ses clients – hors les murs. Mais les Etats ne sont pas indifférents à ces stratégies qui servent aussi leurs intérêts. La diplomatie culturelle, depuis 15 ans, a fortement privilégié ces dossiers de coopération muséale, très prestigieux et très visibles, à l’instar du président russe Vladimir Poutine et du président du conseil italien Romano Prodi qui signèrent un accord entre la ville de Ferrare et l’Ermitage en mars 2007. Avec des bonheurs divers : la ville de Taichung, à Taïwan, refusa par exemple l’implantation d’une antenne Guggenheim en 2003 au nom du refus de « l’hégémonie américaine » ! On peut sourire, mais il faut se souvenir qu’en Europe, lors de l’ouverture du musée de Bilbao, des voix se sont élevées pour dénoncer une relecture biaisée de l’histoire de l’art contemporain : le Guggenheim racontait au public européen une histoire américaine. Laurent Martin – Dans le cas du Louvre, n’oublions pas non plus que ces coopérations s’inscrivent dans le contexte d’échanges bilatéraux qui concernent aussi et avant tout d’autres biens. La France vend par exemple des armes à Abu Dhabi. Il existe donc un croisement d’intérêts dans lequel l’État, qui est signataire de ces accords, trouve son compte. Et pas seulement par rapport au partenaire étranger : la pression exercée par l’Etat sur de grands opérateurs comme le Louvre, afin que leur taux d’autofinancement puisse croître, encourage ces initiatives qui permettent de réduire la participation de l’Etat dans les finances du musée en leur substituant des fonds étrangers : c’est le mécanisme du mécénat à grande échelle. C’est d’ailleurs un généreux mécénat en provenance d’Abu Dhabi qui a permis la restauration récente du château de Fontainebleau. François Chaubet – Le montage d’un projet comme le Louvre-Abu Dhabi est emblématique. La diplomatie d’influence, qui constitue la pierre angulaire de la stratégie du Quai d’Orsay, est fondée sur une expertise technique dont on pourrait trouver des échos aussi bien dans les hôpitaux implantés par la France en Inde que dans le réseau culturel français à l’étranger, qui joue la carte de l’implantation durable et de la coopération avec les partenaires locaux.  Parallèlement, un tel projet témoigne également d’une stratégie de certains émirats arabes qui se projettent déjà dans l’époque de l’après-pétrole : il s’agit pour eux, par l’acquisition d’une « marque » comme le Louvre, de jeter les fondations d’une stratégie touristique au long terme : les grands centres commerciaux ont dans cette optique le même intérêt que les grands musées. Il s’agit de capter, par des marques internationalement connues et reconnues, le flux des 80 millions de touristes chinois qui sortent déjà annuellement de leur pays aujourd’hui, et des Indiens qui leur emboîteront le pas demain… Encore faut-il que le rapport entre les partenaires soit équilibré, qu’ils trouvent un terrain d’entente : le projet de Beaubourg en Chine a ainsi fait long feu, car au « tout business » chinois répondait du côté français un attachement à la valeur scientifique qui a fait achopper les discussions. Dans les pays d’origine, les projets de délocalisation ont parfois suscité des polémiques – on pense notamment à celles qui ont entouré, en France, le projet de Louvre d’Abu Dhabi, ou encore le prêt diplomatique de la Liberté guidant le peuple à la Chine pour 2014. Comment comprendre les réactions qu’on a pu lire et entendre alors ? Laurent Martin – Je pense que l’on peut résumer cette polémique selon la typologie suivante : idéologique, juridique, muséale et politique. Idéologiquement, les opposants au projet ont souligné le côté « marchand » de la démarche qui a fait vendre sa « marque » au Louvre : la marchandisation d’un bien culturel aussi éminent leur semblait révéler un signe des temps, celui du passage d’un bien public universel à un simple « produit » auquel le marché fixe une valeur. Cette réaction a pour conséquence une crispation d’ordre juridique sur le caractère inaliénable des collections en droit public français : même s’il ne s’agit aucunement de vendre des œuvres du Louvre à Abu Dhabi, la contractualisation de prêts au long cours peut passer comme une première étape vers un flux commercial auquel les œuvres d’art des collections publiques n’échapperaient plus. Cette crainte rejoint celle des conservateurs qui se sont interrogés sur la liste des œuvres qui allaient être prêtées par le Louvre (la question des nus, celle de l’origine des artistes représentés) et sur les normes de conservation de ces prêts. Enfin, cette délocalisation, pour un temps long, des œuvres d’un tel musée, a agité la question de la démocratisation culturelle, dans le droit fil du décret du 24 juillet 1959 de Malraux fondant le ministère de la Culture, dont la mission consiste à « rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, par le plus grand nombre de Français » : allait-on priver le public français de ces œuvres au prix d’un contrat avec Abu Dhabi ? Cette tension est donc palpable… On a beau jeu de souligner, comme l’a fait à l’époque Henri Loyrette, le Président-Directeur du Louvre, que tous ces prêts sont encadrés, que le flux d’œuvres existe déjà depuis des décennies, et s’est encore accéléré, avec le principe des grandes expositions, ou que le Louvre a de plus en plus besoin, dans un contexte de compétition mondiale et de raréfaction des deniers publics, de ce type de projets ; on constate que le « modèle Guggenheim » pose question, et fixe des crispations révélatrices de pratiques nouvelles, et problématiques. François Chaubet – Le débat autour du Louvre d’Abu Dhabi est en effet révélateur des discussions autour de ce qu’on appelle le « global marketing », qui a investi le secteur de la culture en favorisant la construction de grands parcs à thème ou l’organisation de festivals. On est entré dans ce que le sociologue Mac Cannell a nommé, en 1976, le tourisme « post-moderne » centré sur la consommation (le Dubai Mall et ses 65 millions de visiteurs annuels) et notamment la consommation d’œuvres culturelles qui peuvent être le bâtiment muséal lui-même : le premier exemple fut justement le Guggenheim de New-York ouvert en 1959, le second l’opéra de Sidney, qui accéda lui aussi au statut d’icône architecturale à consommer au début des années 70 ; puis vint Beaubourg, etc. Le Guggenheim a donc été le premier à saisir ces tendances et à pratiquer une politique de « marque » à diffuser avec Bilbao. Les expositions qu’il a tendance à promouvoir (The art of the Motorcycle à Las Vegas, Armani à Bilbao, Norman Rockwell à New York) s’inscrivent dans ce mouvement de consommation de la culture que ses détracteurs ont taxé de « macdonaldisation » ou de « musée industrialisé » (Rosalind Kraus). Il n’en reste pas moins que les villes prétendant au statut international, notamment en matière de tourisme, veulent désormais leurs bâtiments iconiques et leurs institutions culturelles d’envergure. Ces nouvelles pratiques sont également visibles à l’échelle des grandes universités qui se livrent également une bataille acharnée afin d’attirer les meilleurs étudiants. Elles ne sacrifient pas simplement au classique « brain drain » qui fait que, par exemple, deux-tiers des étudiants en PhD de certains départements scientifiques de Harvard sont constitués d’étudiants non-américains ; elles n’ont pas seulement développé les cours par internet : elles ont également implanté, pour certaines, des antennes à l’étranger. C’est le cas d’universités américaines bien sûr, pionnières en la matière en Europe, et aujourd’hui en Asie ; c’est également la démarche de l’INSEAD à Singapour, de ParisTech à Shanghai, ou de la Sorbonne à… Abu Dhabi ! Ces projections vers l’international sont-elles comparables à celles des musées que nous venons d’évoquer ? François Chaubet – La différence tient sans doute à l’effet d’affichage plus prononcé dans le monde universitaire, plus concurrentiel en termes d’attraction des étudiants. Néanmoins, la notion de soft power est bien présente dans les deux cas : dès qu’une institution se projette à l’étranger, son appartenance nationale y trouve intérêt : il est tout aussi intéressant pour l’État français que le Louvre représente la culture française à l’étranger que l’INSEAD ou ParisTech y forme les élites de demain. L’effet démultiplicateur rencontre parfaitement la stratégie d’influence qui est au cœur de la diplomatie aujourd’hui. Il n’est que de voir, ces dernières années, le développement des Instituts Confucius, pour mesurer à quel point un grand pays comme la Chine, qui était jusqu’alors dépourvu de ce type d’outils, saisit l’intérêt stratégique du soft power auquel tous ces réseaux (musées, universités, instituts culturels) participent étroitement. Laurent Martin – Cette proximité d’analyse musées/universités se retrouve d’ailleurs dans une structuration analogue des réactions qu’on peut régulièrement entendre à propos des universités françaises délocalisées, notamment sur la question de la langue. Certains s’effraient des cours prodigués en anglais, dont la justification par la nécessité d’une compétition avec les universités anglo-saxonnes, d’une perte d’influence du français et d’un conflit opposant soumission aux normes mondialisées à la stratégie développée par l’Etat français en faveur de la langue, notamment via l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. On retrouve cette ligne de crête que nous avons observée dans la polémique liée au projet du Louvre-Abu Dhabi. Évoquons pour terminer les perspectives de ce mouvement de délocalisation : est-il pérenne ? Peut-on penser qu’il va encore se développer ou aurait-on atteint un seuil ? Laurent Martin – Il est difficile de prévoir ce qui peut se produire dans les années à venir, mais il me semble que, si cette pratique devait se développer encore, ce ne pourrait être que de manière modeste. D’abord parce que l’implantation d’un grand musée (et dans une moindre mesure d’une grande université) dans tel lieu rend la concurrence assez délicate : imagine-t-on le British s’installer lui aussi à Abu Dhabi ? Ensuite, parce que rares sont finalement les pays et les institutions qui peuvent avoir ce type d’ambitions : il faut une renommée qui soit véritablement mondiale, et on voit d’ailleurs à quel point certains musées, qui avaient nourri ce genre d’ambitions, ont dû en rabattre. Enfin, les moyens financiers des structures accueillantes doivent souvent être très importants, et cela fixe également une limite… François Chaubet – Ces raisons existent, c’est indéniable. Il me semble cependant que cette tendance a encore de beaux jours devant elle, car elle est portée par une forme de dilution culturelle dans le tourisme international qui va croissant. Ce tourisme va en effet nécessairement croître encore, toutes les prévisions l’affirment, par l’augmentation de la classe moyenne chinoise et de ses pratiques de loisir, et par l’émergence, demain, de celle des Indiens. La consommation culturelle ira nécessairement de pair, car elle fait partie intégrante de ce développement. Alors peut-être le mouvement de délocalisation des grandes institutions culturelles ne prendra-t-il pas nécessairement la forme de franchises, mais les coopérations, sous des formes d’ailleurs aujourd’hui encore méconnues, ont toutes chances d’augmenter dans les décennies à venir. Avec leur corollaire : quelle sera la place réservée à l’autonomie du partenaire ? Car à la croisée des enjeux économiques et politiques se trouve cette question cruciale en termes d’équilibre des civilisations… Article de : www.paristechreview.com
Parallèlement, un tel projet témoigne également d’une stratégie de certains émirats arabes qui se projettent déjà dans l’époque de l’après-pétrole : il s’agit pour eux, par l’acquisition d’une « marque » comme le Louvre, de jeter les fondations d’une stratégie touristique au long terme : les grands centres commerciaux ont dans cette optique le même intérêt que les grands musées. Il s’agit de capter, par des marques internationalement connues et reconnues, le flux des 80 millions de touristes chinois qui sortent déjà annuellement de leur pays aujourd’hui, et des Indiens qui leur emboîteront le pas demain… Encore faut-il que le rapport entre les partenaires soit équilibré, qu’ils trouvent un terrain d’entente : le projet de Beaubourg en Chine a ainsi fait long feu, car au « tout business » chinois répondait du côté français un attachement à la valeur scientifique qui a fait achopper les discussions. Dans les pays d’origine, les projets de délocalisation ont parfois suscité des polémiques – on pense notamment à celles qui ont entouré, en France, le projet de Louvre d’Abu Dhabi, ou encore le prêt diplomatique de la Liberté guidant le peuple à la Chine pour 2014. Comment comprendre les réactions qu’on a pu lire et entendre alors ? Laurent Martin – Je pense que l’on peut résumer cette polémique selon la typologie suivante : idéologique, juridique, muséale et politique. Idéologiquement, les opposants au projet ont souligné le côté « marchand » de la démarche qui a fait vendre sa « marque » au Louvre : la marchandisation d’un bien culturel aussi éminent leur semblait révéler un signe des temps, celui du passage d’un bien public universel à un simple « produit » auquel le marché fixe une valeur. Cette réaction a pour conséquence une crispation d’ordre juridique sur le caractère inaliénable des collections en droit public français : même s’il ne s’agit aucunement de vendre des œuvres du Louvre à Abu Dhabi, la contractualisation de prêts au long cours peut passer comme une première étape vers un flux commercial auquel les œuvres d’art des collections publiques n’échapperaient plus. Cette crainte rejoint celle des conservateurs qui se sont interrogés sur la liste des œuvres qui allaient être prêtées par le Louvre (la question des nus, celle de l’origine des artistes représentés) et sur les normes de conservation de ces prêts. Enfin, cette délocalisation, pour un temps long, des œuvres d’un tel musée, a agité la question de la démocratisation culturelle, dans le droit fil du décret du 24 juillet 1959 de Malraux fondant le ministère de la Culture, dont la mission consiste à « rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, par le plus grand nombre de Français » : allait-on priver le public français de ces œuvres au prix d’un contrat avec Abu Dhabi ? Cette tension est donc palpable… On a beau jeu de souligner, comme l’a fait à l’époque Henri Loyrette, le Président-Directeur du Louvre, que tous ces prêts sont encadrés, que le flux d’œuvres existe déjà depuis des décennies, et s’est encore accéléré, avec le principe des grandes expositions, ou que le Louvre a de plus en plus besoin, dans un contexte de compétition mondiale et de raréfaction des deniers publics, de ce type de projets ; on constate que le « modèle Guggenheim » pose question, et fixe des crispations révélatrices de pratiques nouvelles, et problématiques. François Chaubet – Le débat autour du Louvre d’Abu Dhabi est en effet révélateur des discussions autour de ce qu’on appelle le « global marketing », qui a investi le secteur de la culture en favorisant la construction de grands parcs à thème ou l’organisation de festivals. On est entré dans ce que le sociologue Mac Cannell a nommé, en 1976, le tourisme « post-moderne » centré sur la consommation (le Dubai Mall et ses 65 millions de visiteurs annuels) et notamment la consommation d’œuvres culturelles qui peuvent être le bâtiment muséal lui-même : le premier exemple fut justement le Guggenheim de New-York ouvert en 1959, le second l’opéra de Sidney, qui accéda lui aussi au statut d’icône architecturale à consommer au début des années 70 ; puis vint Beaubourg, etc. Le Guggenheim a donc été le premier à saisir ces tendances et à pratiquer une politique de « marque » à diffuser avec Bilbao. Les expositions qu’il a tendance à promouvoir (The art of the Motorcycle à Las Vegas, Armani à Bilbao, Norman Rockwell à New York) s’inscrivent dans ce mouvement de consommation de la culture que ses détracteurs ont taxé de « macdonaldisation » ou de « musée industrialisé » (Rosalind Kraus). Il n’en reste pas moins que les villes prétendant au statut international, notamment en matière de tourisme, veulent désormais leurs bâtiments iconiques et leurs institutions culturelles d’envergure. Ces nouvelles pratiques sont également visibles à l’échelle des grandes universités qui se livrent également une bataille acharnée afin d’attirer les meilleurs étudiants. Elles ne sacrifient pas simplement au classique « brain drain » qui fait que, par exemple, deux-tiers des étudiants en PhD de certains départements scientifiques de Harvard sont constitués d’étudiants non-américains ; elles n’ont pas seulement développé les cours par internet : elles ont également implanté, pour certaines, des antennes à l’étranger. C’est le cas d’universités américaines bien sûr, pionnières en la matière en Europe, et aujourd’hui en Asie ; c’est également la démarche de l’INSEAD à Singapour, de ParisTech à Shanghai, ou de la Sorbonne à… Abu Dhabi ! Ces projections vers l’international sont-elles comparables à celles des musées que nous venons d’évoquer ? François Chaubet – La différence tient sans doute à l’effet d’affichage plus prononcé dans le monde universitaire, plus concurrentiel en termes d’attraction des étudiants. Néanmoins, la notion de soft power est bien présente dans les deux cas : dès qu’une institution se projette à l’étranger, son appartenance nationale y trouve intérêt : il est tout aussi intéressant pour l’État français que le Louvre représente la culture française à l’étranger que l’INSEAD ou ParisTech y forme les élites de demain. L’effet démultiplicateur rencontre parfaitement la stratégie d’influence qui est au cœur de la diplomatie aujourd’hui. Il n’est que de voir, ces dernières années, le développement des Instituts Confucius, pour mesurer à quel point un grand pays comme la Chine, qui était jusqu’alors dépourvu de ce type d’outils, saisit l’intérêt stratégique du soft power auquel tous ces réseaux (musées, universités, instituts culturels) participent étroitement. Laurent Martin – Cette proximité d’analyse musées/universités se retrouve d’ailleurs dans une structuration analogue des réactions qu’on peut régulièrement entendre à propos des universités françaises délocalisées, notamment sur la question de la langue. Certains s’effraient des cours prodigués en anglais, dont la justification par la nécessité d’une compétition avec les universités anglo-saxonnes, d’une perte d’influence du français et d’un conflit opposant soumission aux normes mondialisées à la stratégie développée par l’Etat français en faveur de la langue, notamment via l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. On retrouve cette ligne de crête que nous avons observée dans la polémique liée au projet du Louvre-Abu Dhabi. Évoquons pour terminer les perspectives de ce mouvement de délocalisation : est-il pérenne ? Peut-on penser qu’il va encore se développer ou aurait-on atteint un seuil ? Laurent Martin – Il est difficile de prévoir ce qui peut se produire dans les années à venir, mais il me semble que, si cette pratique devait se développer encore, ce ne pourrait être que de manière modeste. D’abord parce que l’implantation d’un grand musée (et dans une moindre mesure d’une grande université) dans tel lieu rend la concurrence assez délicate : imagine-t-on le British s’installer lui aussi à Abu Dhabi ? Ensuite, parce que rares sont finalement les pays et les institutions qui peuvent avoir ce type d’ambitions : il faut une renommée qui soit véritablement mondiale, et on voit d’ailleurs à quel point certains musées, qui avaient nourri ce genre d’ambitions, ont dû en rabattre. Enfin, les moyens financiers des structures accueillantes doivent souvent être très importants, et cela fixe également une limite… François Chaubet – Ces raisons existent, c’est indéniable. Il me semble cependant que cette tendance a encore de beaux jours devant elle, car elle est portée par une forme de dilution culturelle dans le tourisme international qui va croissant. Ce tourisme va en effet nécessairement croître encore, toutes les prévisions l’affirment, par l’augmentation de la classe moyenne chinoise et de ses pratiques de loisir, et par l’émergence, demain, de celle des Indiens. La consommation culturelle ira nécessairement de pair, car elle fait partie intégrante de ce développement. Alors peut-être le mouvement de délocalisation des grandes institutions culturelles ne prendra-t-il pas nécessairement la forme de franchises, mais les coopérations, sous des formes d’ailleurs aujourd’hui encore méconnues, ont toutes chances d’augmenter dans les décennies à venir. Avec leur corollaire : quelle sera la place réservée à l’autonomie du partenaire ? Car à la croisée des enjeux économiques et politiques se trouve cette question cruciale en termes d’équilibre des civilisations… Article de : www.paristechreview.com

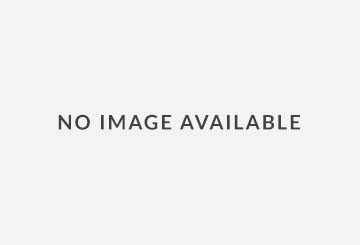

You must be logged in to post a comment.